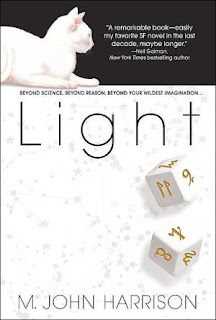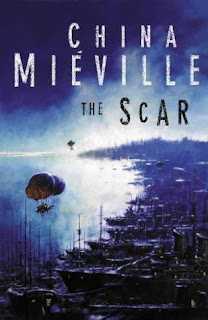En plusieurs décennies de carrière, l’écrivain britannique M. John Harrison a su se tailler une réputation d’auteur SF/Fantasy incontournable, représentant la nouvelle vague aux côtés de grands noms du genre comme Michael Moorcock ou Ian M. Banks. En se promenant sur le net, on s’aperçoit qu’il semble cristalliser les passions et les avis sur son oeuvre sont plutôt tranchés, du genre : « c’est le plus grand auteur de la SF britannique moderne » ou « ce type est un escroc. » L’une des caractéristiques de son oeuvre semble être d’avoir redonné à la SF ou la fantasy ses lettres de noblesse et une place dans « la grande littérature ».
En français, Light est chroniqué sur deux des principaux sites dédiés à la SFFF, à savoir le Cafard cosmique et Sci-fi Universe. Heureusement, aucune de leurs critiques ne correspond vraiment à l’impression que m’a laissé ce livre donc cette chronique a encore lieu d’être !
Chez le cafard, la critique est même dithyrambique au point de tourner au ridicule. Je ne résiste pas à vous livrer cet extrait:
« Des personnages remarquables de crédibilité, attachants, déchirés, angoissés, paniqués, auxquels on s’identifie avec une facilité déconcertante, une narration parfaitement maîtrisée, un style inimitable, Light laisse pantois une fois la dernière page tournée. De par sa très haute tenue littéraire, sa fluidité, la profondeur du propos et l’évidente vigueur de la prose, ce roman est appelé à faire date. » « Un vrai grand roman, de ceux qui rassurent, réconfortent et enthousiasment. »
Car il serait difficile de faire des personnages auxquels on s’identifie moins (quoique) que les trois protagonistes de Light: un serial killer, une pré-ado mal dans sa peau et un addict libineux aux mondes virtuels qui peuplent un roman décalé en forme de rêve monstrueux qui est tout, sauf rassurant.
Dans Light, on suit le parcours de Michael Kearney, un physicien névrosé qui découvre les bases théoriques d’un moteur permettant les voyages interstellaires mais aussi un tueur en série qui sévit depuis 20 ans pour exorciser la némésis qu’il passe son temps à fuir : une créature à tête de cheval qui peut se matérialiser n’importe quand et n’importe où. Lorsqu'il n'est pas occupé à s'enfuir à l'autre bout de l'Atlantique ou à baiser son ex-femme, Il travaille dans un labo avec son partenaire, Tate, qui fait l’essentiel du travail et élève un chat noir et et une chatte blanche
Seria Mau fut jadis une petite fille de treize ans. En stase dans un sarcophage, son système nerveux est relié à celui du White Cat, vaisseau spatial et relique dépositaire d’une technologie extraterrestre antique. Ayant perdu son humanité, elle fait figure d’être déchu qui, elle aussi, fuit ses peurs en se propulsant dans l’hyperespace. Elle est pourchassée par un croiseur appartenant aux Nastic, une culture extraterrestre contemporaine de l’humanité et son ancien employeur.
Ed Chianese est un ancien pilote de vaisseau spatial. Il a sombré dans l’addiction aux univers virtuels et se vautre dans les stases de "cyberfermes" où il passe des semaines entière à vivre des aventures de film noir jusqu’à ce qu’il ait dépensé toutes ses maigres économies et doive revenir à la réalité pour reprendre un petit boulot. A l’instar des deux autres personnages, dès son réveil, il est poursuivit par la pègre du quartier, à savoir deux matronnes dures à cuire auxquelles il doit un peu trop d’argent.
Le dernier "personnage" est le « Kefuhachi Tract », un immense coin d’espace où les règles de la physique ne fonctionnent pas comme elles le devraient et qui a résisté à toutes les tentatives d’approches des nombreuses civilisations extraterrestres qui se sont relayées pour tenter d’en percer son mystère depuis 65 millions d’années. Harrison adopte l’approche de John Scalzi ou du chinois Liu Cixin, celle d’un univers qui grouille de civilisations extraterrestres possèdant des technologies de voyage intersidéral. C’est l’un des aspects les plus fascinants de la partie Space Op du roman.
Pour revenir aux personnages, ils partagent donc ce manque de repère et cette part de leur vie qu’ils refoulent dans une fuite éperdue. M. John Harrison a, il faut le reconnaître, une écriture très agréable et fluide. Il jongle avec aisance entre les différents genres de ses trois récits entremêlés : Space Opéra, Roman Noir et récit fantastique.
Le décor planté dans chaque narration regorge d’idées intéressantes et les atmosphères sont subtiles et délicatement sculptées par une prose sans faille. L’alternance des narrations peut déranger au début de l’oeuvre, mais je l’ai trouvée pour ma part très maîtrisée. Au fur et à mesure que l’histoire avance, chaque passage narratif consacré à l’un des personnages s’allonge et l’on est facilement happé dans une histoire qui concède les révélations au compte goutte.
L’absurdité et l’onirisme sont des thèmes majeurs de l’histoire. Ils sont la marque de fabrique de l’auteur et l’élément le plus susceptible de dérouter le lecteur de SFFF habitué à certains codes du genre. C’est ainsi qu’il ne faut pas toujours chercher de logique à l’enchaînement des actions qui ressemblent bien souvent à des rêves avec leur lot d’impromptu et de symbolisme.
C’est à la fois la force et la faiblesse du roman. Force parce qu’il confère aux images suggérées par Harrison une force surprenante – les apparitions du shrander sont d’autant plus mémorables et terrifiantes qu’elles ont aléatoires et phantasmagoriques – faiblesse car on tombe parfois dans l’anecdotique et l’ennuyeux. Une fois que le décor et la trame prometteuse de l’histoire sont mis en place, il faut bien dire qu’il ne se passe pas grand chose jusqu’à un dénouement qui apparait un peu baclé et complètement décalé par rapport au ton général du roman...
Un autre point qui unit les personnages est la débauche de sexe proprement ahurissante qui emplit les pages du roman. Le sexe ou l’absence de sexe constituent l’un des principaux moyens d’interaction des personnages de Light. Lors qu’ils ne sont pas occupés à fuir, Michael et Ed passent le plus clair de leur temps à baiser tous les personnages féminins qu’ils rencontrent avec une sorte d’obsession cathartique. Seria Mau, dont l'enveloppe corporelle est devenue superflue, est prisonnière d'un vaisseau qui est devenu sa tombe et l'isole de ses anciens congénères et donc, de tout rapport charnel.
Malgré des défauts qui seront pour certains ses qualités, Light est une lecture plutôt recommandable, un roman transgenre, hybride, qui réussit le tour de force de marier plusieurs styles à une seule histoire. Le talent incontestable de l’auteur a le mérite de ne pas laisser indifférent et on sent également qu’on a là une écrite riche et profonde qui se dévoile lentement au lecteur patient. Reste que sur le marché du livre, les qualités de cet ovni de la littérature sont également son tombeau : Light n'est probablement pas un succès de libraire, et ce même au rayon fantasy mais ce n'est pas une raison pour bouder son plaisir. J’enchaînerai pour ma part sur la suite, Nova Swing, dès que ma pile à lire m’en laissera le répit.
Pour terminer, voici les couvertures des éditions françaises et anglaises. Radicalement différentes non? Côté anglais, on a une couverture qui puise directement dans les élements de l'histoire et s'écarte avec fraîcheur des couvertures lambda des bouquins de SF. De l'autre, dans l'édition française, c'est le sempiternel vaisseau spatial qui place irrémédiablement le livre dans l'étroite catégorie de la SF à gros vaisseau. Pas forcément mensonger, mais réducteur et sans la finesse de la couverture anglaise Dommage!
Et pour référence, une interview éclairante du bonhomme sur Amazon.